|
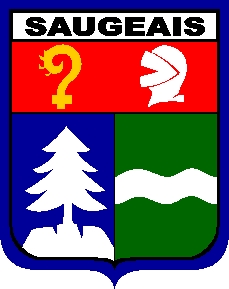
Les armoiries saugettes, qui ont été créées en 1973 par
le colonel Henri de SAINT-FERJEUX, résument assez bien la situation
géographique du pays et son histoire.
Divisées en trois quartiers, elles
sont surmontées de la mention "Saugeais". Situés dans le quartier supérieur,
la crosse abbatiale et le heaume rappellent le rôle des sires de Joux et des
moines bâtisseurs de l'abbaye de Montbenoît dans l'histoire du val de
Saugeais. Dans le quartier inférieur gauche, le sapin sur
la montagne illustre la situation montagneuse du pays tandis que, dans le
quartier inférieur droit, le ruban d'argent représente le Doubs qui coule au
coeur de la République.
Ces armoiries figurent sur un timbre qui a été émis
par la poste française le 21 septembre 1987 et gravé par Jean DELPECH.
Les origines
L'origine du pays sauget remonte au
12ème siècle.
Vers l’an 1100, un ermite du nom de BENOÎT vit avec une
petite communauté et donne ainsi à la région son nom de Mont Benoît. Vers 1150,
LANDRY, sire de Joux, fait don de ce territoire inculte, situé dans la haute
vallée du Doubs, en aval de Pontarlier, à HUMBERT, archevêque de Besançon. Ce
dernier y envoie des religieux vivant sous la règle de Saint-Colomban et à la
tête desquels se trouve NARDUIN chargés de mettre en valeur le pays. Les moines
défrichent la région et édifient une abbaye à Montbenoît, autour de laquelle
vont se grouper onze communes, qui représentent aujourd'hui près de 3500
habitants. Pour les aider dans cette tâche, l'archevêque de Besançon fait venir
de Suisse des Saugets, colons du canton des Grisons, et des Savoyards.
Cette terre est appelée pour la première fois en 1199, "Val
del Saugey". Sous la domination des sires de Joux jusqu'au 14ème siècle, le "Val
del Saugey" passa sous l'autorité des moines de l'abbaye, véritable puissance
seigneuriale.
La colonisation progressive du val du Saugeais
L'action et le travail des chanoines favorisèrent la colonisation du
Saugeais. Ainsi apparurent
villages et hameaux qui relevaient de la juridiction seigneuriale de l'abbé et
qui constituaient une seule et même paroisse.
Ces villages sont Montbenoît, La Longeville, Ville du Pont, Hauterive, Les Alliés, Arçon, Bugny,
La Chaux de Gilley, Maisons du Bois-Lièvremont et Montflovin. Ils se sont construits les
uns après les autres. D’abord Montbenoît et Arçon, puis aux environs de 1744 on
signale l’existence de Montflovin et Hauterive. Le village des Alliés, à ses
débuts, s’appelait Les Arcenets, du nom des gens venus d’Arçon pour le
défricher. Après l’épidémie de peste, on fit appel à une colonie venue de suisse
Alémanique, et le village fut baptisé « Les Allemands ». Le 11 octobre 1915,
sous Raymond POINCARÉ, il prit le nom des Alliés. Pendant l’Occupation, il fut à
nouveau nommé « Les Allemands », puis reprit son qualificatif actuel à la
libération. Les églises des communes précitées se sont construites en 1150 à Montbenoît,
en 1426 à Arçon, en 1600 à Lièvremont, en 1632 à Ville-du-Pont, en 1636 aux
Alliés, en 1665 à Gilley et en 1673 à La Chaux-de-Gilley et Bugny.
Cette unité politique et
religieuse, favorisée par l'installation des Saugets dans la région, suscita un
sentiment de communauté, qui s'exprima dans les coutumes, le dialecte, qui fut
parlé couramment jusqu'en 1900, et l'histoire du pays.
Le déclin du Saugeais
La création d'églises vicariales (17ème siècle),
l'affranchissement de la main morte (1744), l'ouverture sur l'extérieur et
l'exode rural, ainsi que la fermeture de l'abbaye en 1773, ont failli faire
perdre au Saugeais son identité en voyant s'estomper son
unité et ses particularismes.
L'avènement de la République et la renaissance du Saugeais
En 1947, à l'occasion d'un conseil de
révision, M. OTTAVIANNI, préfet
du Doubs, fait halte à l’Hôtel de l’Abbaye à Montbenoît. Georges POURCHET,
directeur de l’établissement, demande en plaisantant à son hôte prestigieux s’il
a "un laissez-passer pour entrer dans la République du Saugeais". Interloqué,
le préfet demande des précisions. On lui explique alors que le Saugeais est une
région à part dans le Haut Doubs, avec un fort sentiment régionaliste. Le
préfet, devant tant de conviction, joue le jeu et décrète : "Puisqu’il n’y a
pas de président dans votre république, monsieur POURCHET, je vous nomme
Président de la République du Saugeais". C’est ainsi que les Saugets obtinrent
leur indépendance, sans heurt et avec humour.
À la mort de M. POURCHET en 1968,
personne ne reprit le flambeau. Quatre ans plus tard, alors que Mme veuve
POURCHET participe activement à la restauration de l’abbaye de Montbenoît, les
Saugets, sur proposition de l'abbé JEANTET et du maire de Montbenoît, la prient de reprendre les fonctions de son défunt mari. « J’ai été élue
à l’applaudimètre lors du repas de la kermesse organisée au bénéfice de la
restauration de l’abbaye », aime-t-elle à raconter.
Sous son impulsion, la République se
dote d'un drapeau (noir, rouge, jaune), d'un timbre, d'une monnaie et de deux
douaniers volants chargés d'intercepter les touristes attirés par cette curieuse
République et de leur délivrer des laissez-passer.
En février 2001, les relations diplomatiques
avec la France se sont nettement refroidies : la République du Saugeais,
«libre, indivisible et souveraine», venait de se doter d'une constitution...
Pour ne rien arranger, le sous-préfet de Pontarlier prit la mouche après avoir
été pris sans laissez-passer à la douane. Le 15 août 2005, une rencontre au
sommet entre Gabrielle POURCHET et le nouveau sous-préfet a semble-t-il permis
d'aplanir le différend.
Mise en ligne le 3 septembre 2005, dernière mise à jour le
31 juillet 2006. |